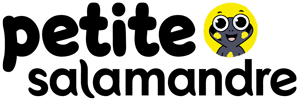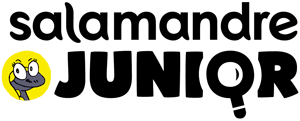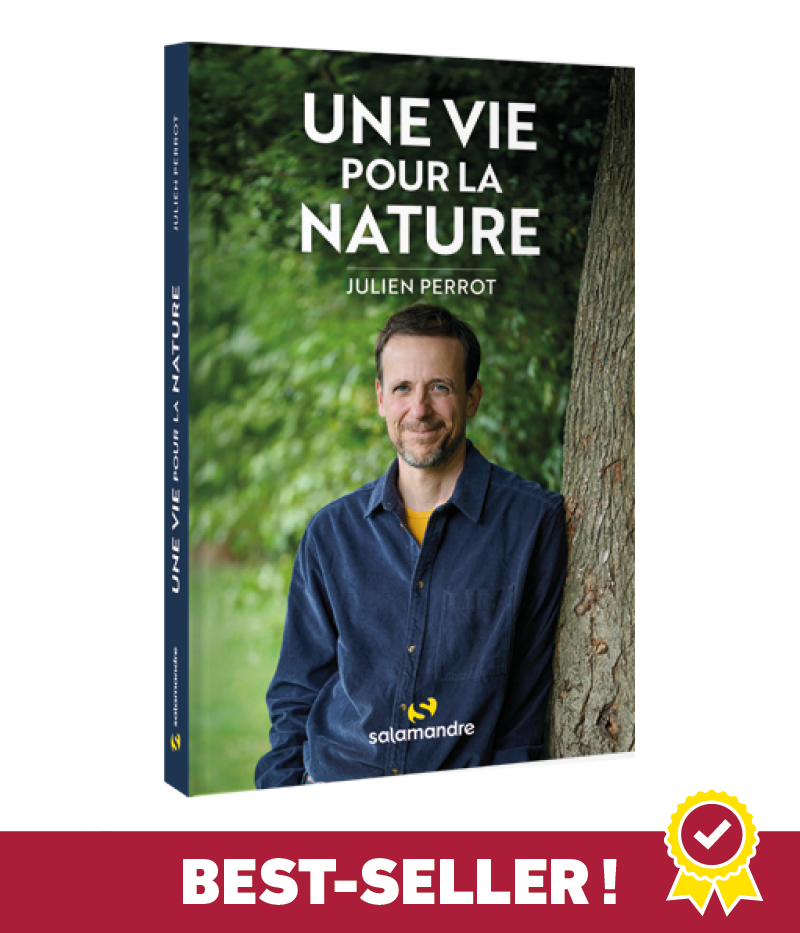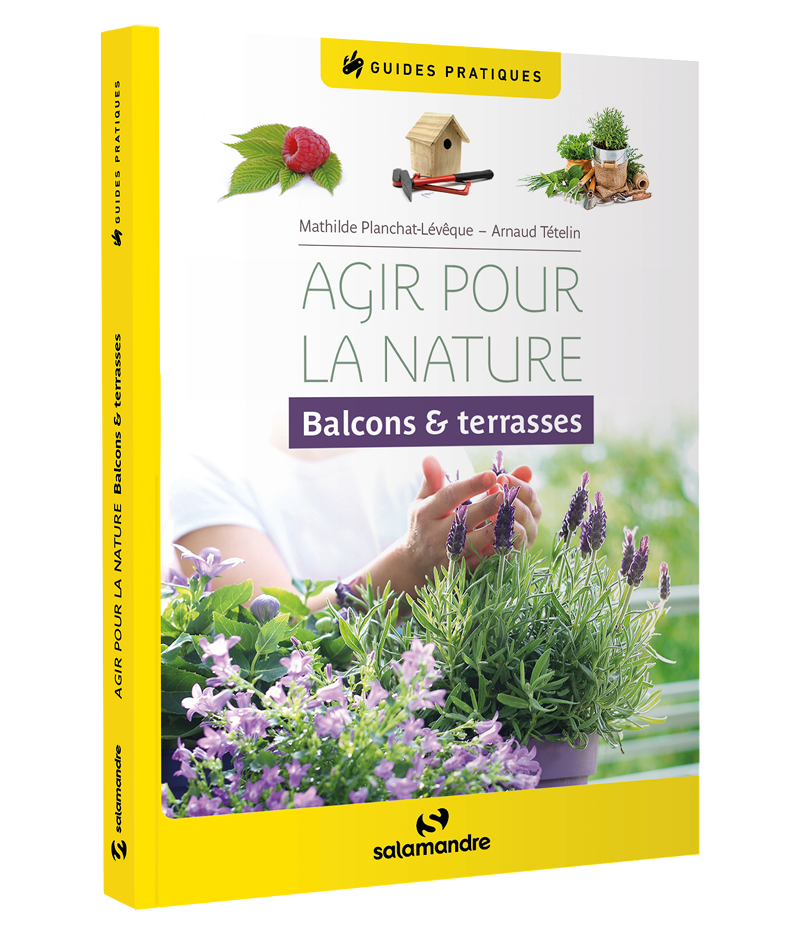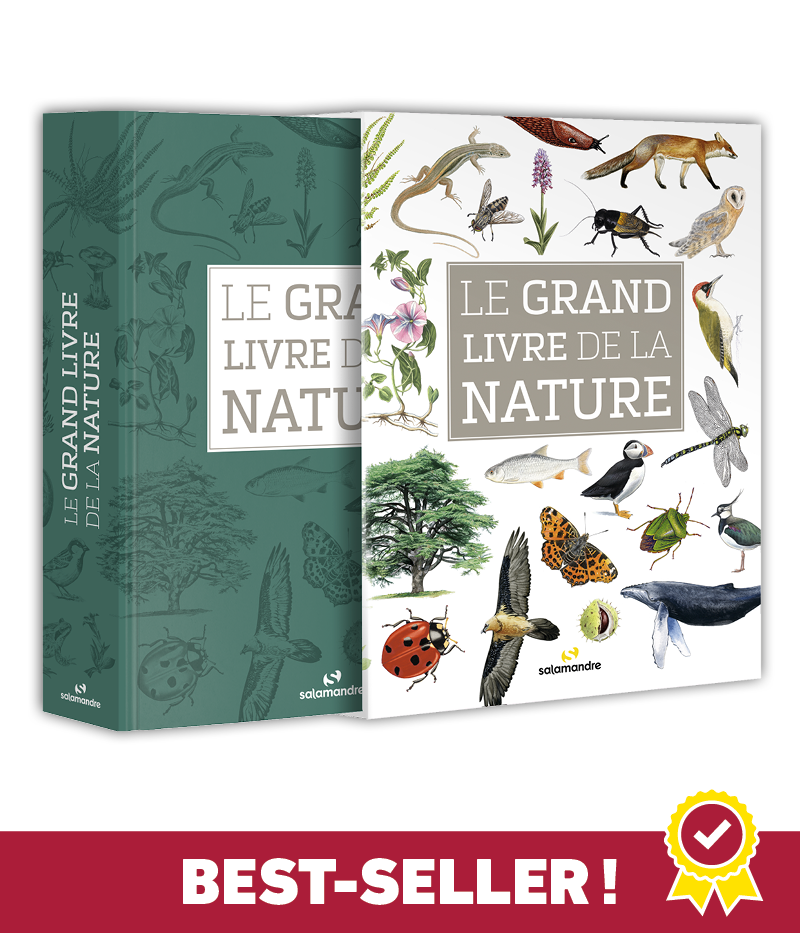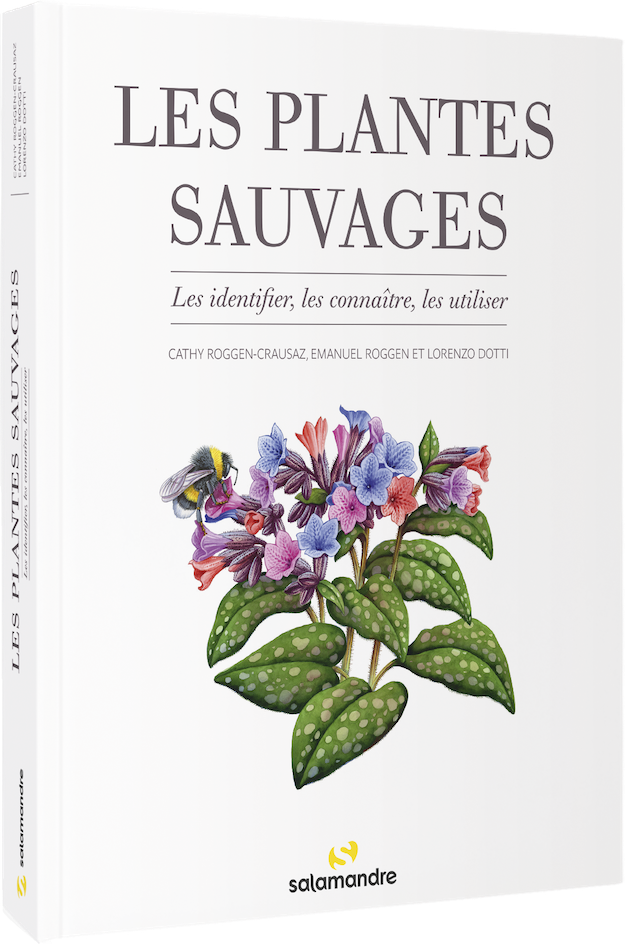Quand une princesse aida à la réintroduction du castor
Désormais commun dans les cours d’eau helvétiques, le castor d’Europe avait pourtant disparu du pays au 19e siècle. Jusqu’à ce que dans les années 1950, une bande de naturalistes le réintroduise avec moult péripéties…
Désormais commun dans les cours d’eau helvétiques, le castor d’Europe avait pourtant disparu du pays au 19e siècle. Jusqu’à ce que dans les années 1950, une bande de naturalistes le réintroduise avec moult péripéties…
La présence du castor en Suisse est désormais aussi large que sa queue. Les derniers recensements font état d’environ 5 000 individus qui ont colonisé l'entièreté du Plateau et s’aventurent désormais loin dans les contrées alpines, par exemple en vallée du Rhône en Valais ou sur les rives du Rhin alpin dans les Grisons. Disparu de nos contrées au début du 19e siècle à cause de la chasse qui lui a été menée pour sa viande et sa fourrure, le castor d’Europe a été réintroduit par les humains dans les années 1950. Son prolifique retour est considéré comme un magnifique succès.
Pourtant, les premiers lâchés du mammifère semi-aquatique ont été rocambolesques et n’auguraient pas d’une telle réussite. Tout commence en 1956. Quatre hommes se retrouvent en novembre au bord du Gardon dans le sud de la France. Ces naturalistes membres de l’association genevoise pour la protection de la nature (devenue depuis Pro Natura Genève) ont obtenu des autorités françaises la permission de capturer des castors - une population a miraculeusement survécu dans les marais de Camargue - pour les ramener en Suisse en vue d’une réintroduction.

Une princesse comme alliée
Mais sur place les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Le quatuor emmené par Robert Hainard et Maurice Blanchet, deux légendes dans le milieu environnementaliste, campe pendant près de trois semaines sans réussir à attraper un seul rongeur. Les pièges fabriqués ne fonctionnent pas. Jusqu’à ce qu’un retournement de situation transforme le script en un conte de fées. C’est le naturaliste Maurice Blanchet, décédé en 1978, qui le raconte le mieux dans son livre Le Castor et son royaume. « Le garde-pêche nous prend en pitié; il nous persuade de lever le camp et de tenter notre chance en amont chez la princesse de Croy. Il nous apprit que cette princesse n’aimait pas les castors, qu’elle accusait de provoquer, en creusant leurs terriers, l’éboulement des berges du Gardon limitant son domaine.»
Sur les terres de la princesse, les rongeurs sont facilement repérables et les compères parviennent finalement à capturer leur premier spécimen. Hélas celui-ci mourut rapidement en captivité en Suisse, l’autorisation de réintroduction n’étant pas encore actée par les autorités fédérales. En 1957, une nouvelle expédition permet de ramener trois nouveaux castors : une femelle et ses deux petits. Mais là encore, tout ne se passe pas comme prévu. Enfermée dans un parc d’un hectare à proximité de la Versoix, la petite famille se déchire. La mère tue ses deux petits et souffre de la captivité. «Cette bête, avec une obstination misérable, arpentait chaque nuit les limites de son parc», témoigne Maurice Blanchet.

La grande évasion
Puis, c’est comme si la nature décidait de donner un coup de pouce à cette mission de la dernière chance. Le 6 janvier 1958, une crue ouvre une brèche dans l’enclos. Las d’attendre une autorisation de mise en liberté de leur animal, les naturalistes agrandissent le trou. «Le soir même, nous recevions un téléphone de Berne nous informant que nous étions autorités à lâcher en Suisse des castors en liberté», s'ébaudit Maurice Blanchet.
La suite sera davantage un long fleuve tranquille - ce qu’adorent les castors d’ailleurs. Entre 1958 et 1977, des lâchers sont effectués sur 30 sites différents dans le pays pour un total de 141 individus. D’abord lente, la croissance de la population s’accélère au début des années 2000. Il y avait 454 castors en 1993, puis 1602 en 2008. Lors du dernier recensement national lors de l’hiver 2021-2022, 4914 spécimens sont comptabilisés. Un effectif que les pionniers n’auraient jamais imaginé, même dans leurs rêves les plus fous.

Trois questions à…Cécile Auberson, biologiste, spécialiste du castor chez info fauna
Pourquoi le castor a-t-il disparu d’Europe ?
Au début du 19e, on comptait seulement 1000 castors dans toute l'Eurasie à cause de la chasse. Ils étaient tués pour leur viande et leur fourrure. Le castor a l’une des fourrures les plus denses du monde animal et des poils de bourre qui feutrent très bien. Les chapeaux en poil de castor ont été très à la mode. La petite anecdote : on entend souvent parler de la ruée vers l’or, mais avant cela il y a aussi eu une ruée vers la fourrure. La poussée des Occidentaux toujours plus à l’ouest en Amérique du Nord a été largement motivée par la chasse au castor.
La réintroduction du castor en Suisse dans les années 1950 n’a pas été simple. Des erreurs ont-elles été faites à l’époque ?
Les initiateurs du projet étaient convaincus que le castor ne pouvait s’adapter qu’à des zones d’eau très naturelles, peu anthropisées. Ils se sont basés sur cette idée pour choisir leurs sites de réintroductions, mais cela a parfois conduit à des erreurs. Par exemple, à Neuchâtel, deux castors ont été lâchés dans les gorges de l’Areuse. C’est très encaissé, le débit de la rivière est important. Ce n’est vraiment pas un habitat pour les castors. Finalement, l’un des deux castors a été victime d’un accident de la route en voulant traverser une passerelle. L’autre a été retrouvé quelques semaines après complètement épuisé. Il a été recueilli par un service vétérinaire qui l’a soigné puis relâché de nouveau dans les gorges. La nuit suivante, il y a eu une vague de froid, l’Areuse a gelé et on n'a jamais retrouvé ce castor.
Finalement, la population explose depuis les années 2000. Pourquoi ce boom démographique un demi-siècle après les premiers lâchés ?
La courbe de croissance des populations animales est assez typique, D’abord un démarrage lent avec là des effectifs de base très faibles. Donc cela prend du temps pour la reproduction puis la colonisation de nouveaux milieux. Maintenant, on est dans une phase exponentielle. Et puis on va atteindre à un moment donné un plateau. Quand tous les habitats disponibles seront saturés. Dans certains endroits, comme au nord du lac de Thoune, on voit déjà un ralentissement du taux de croissance.
Catégorie
Ces produits pourraient vous intéresser
Poursuivez votre découverte
La Salamandre, c’est des revues pour toute la famille
Plongez au coeur d'une nature insolite près de chez vous
Donnez envie aux enfants d'explorer et de protéger la nature
Faites découvrir aux petits la nature de manière ludique
merci de ne pas les utiliser sans l'accord de l'auteur