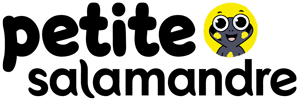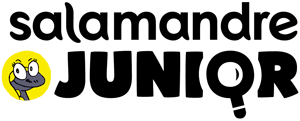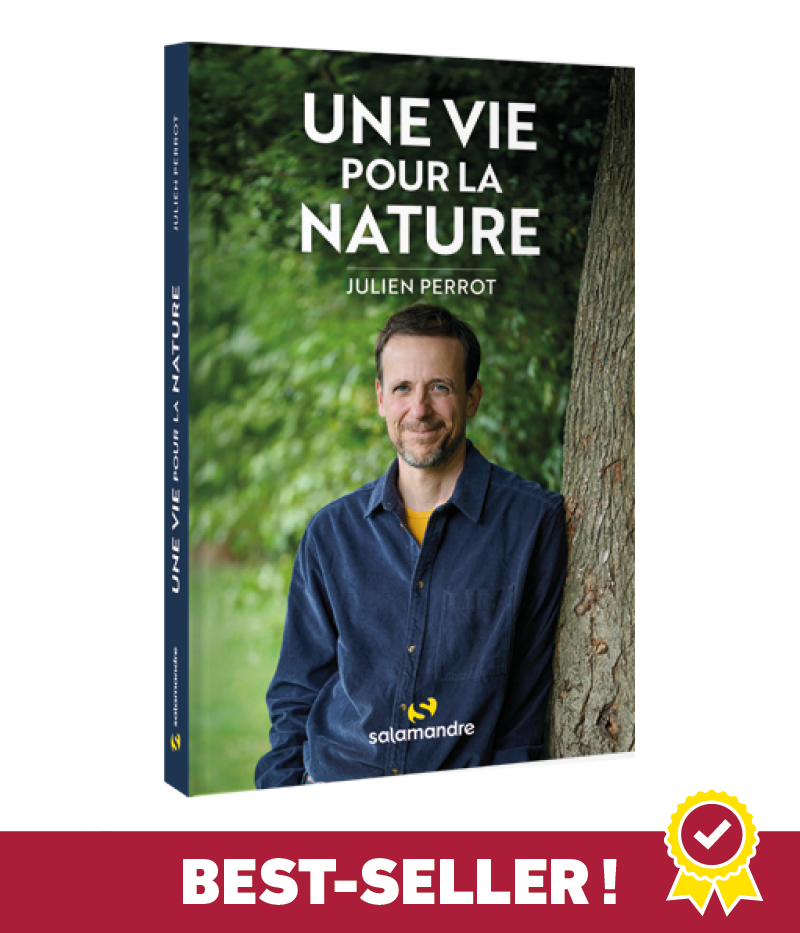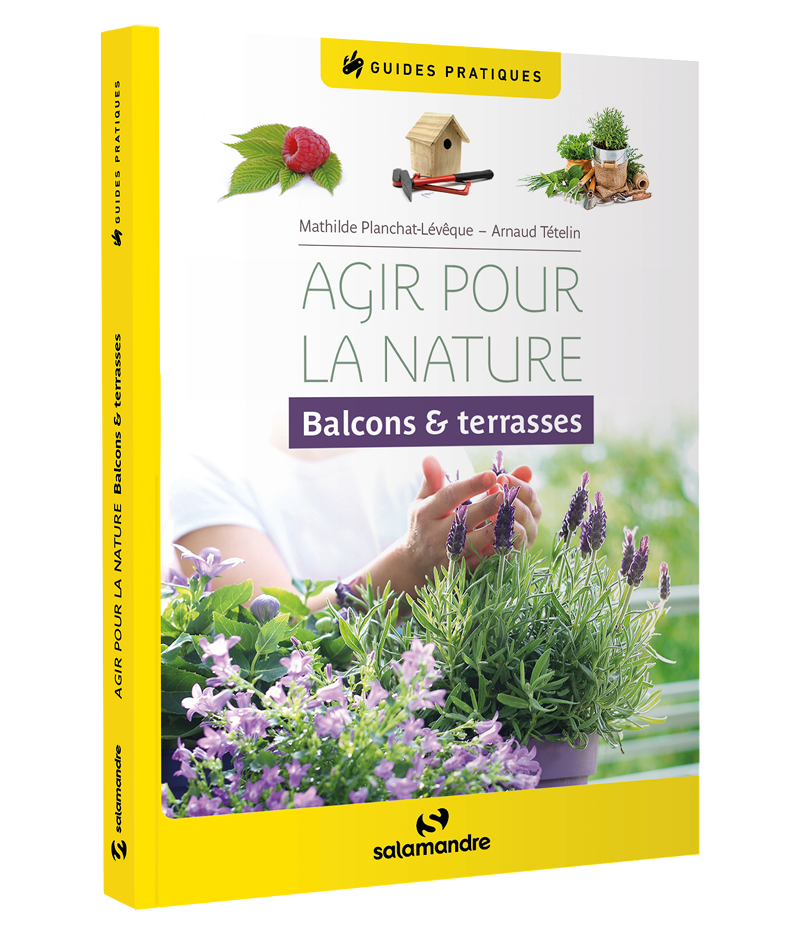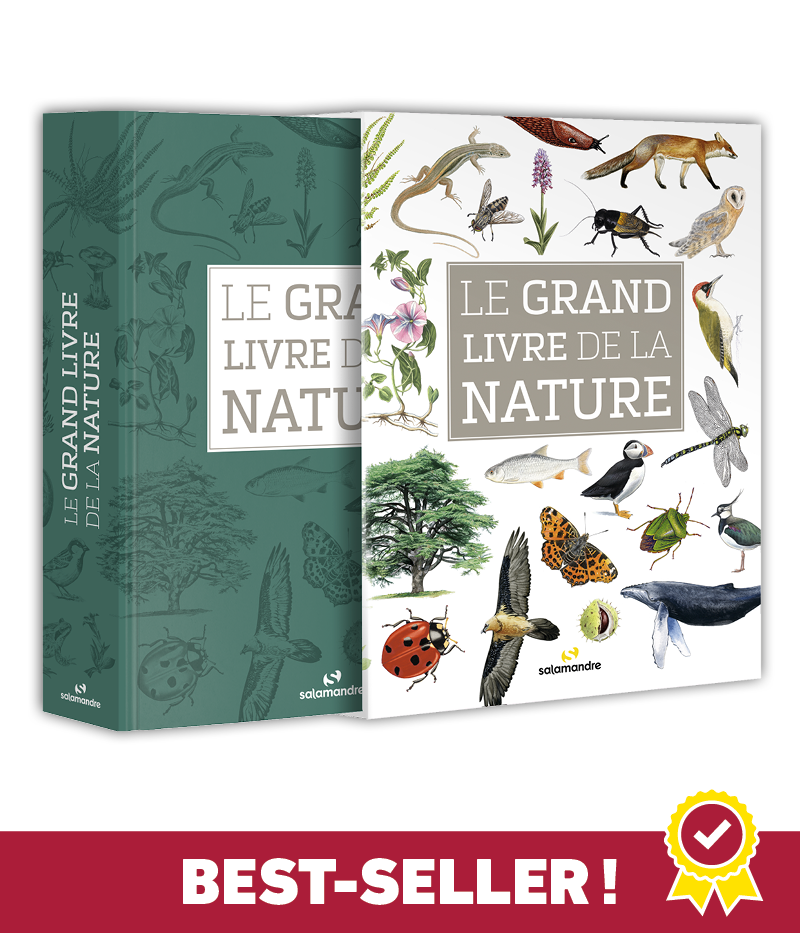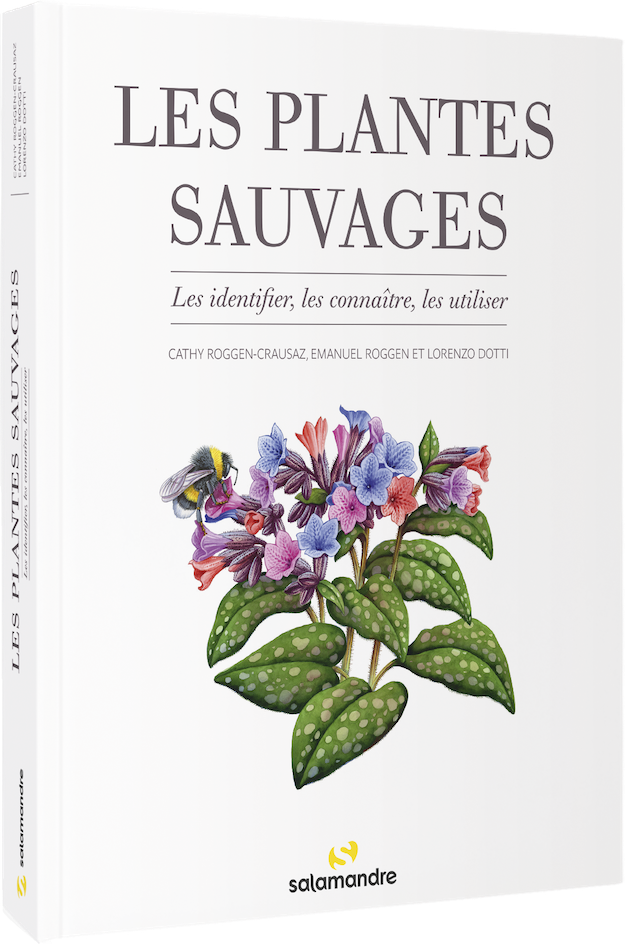La cistude, un retour à allure de tortue
Quasiment disparue de Suisse au début du siècle, la tortue cistude bénéficie d’un programme de réintroduction. Au centre Emys, partenaire du programme, les premières naissances ont eu lieu cette année.
Quasiment disparue de Suisse au début du siècle, la tortue cistude bénéficie d’un programme de réintroduction. Au centre Emys, partenaire du programme, les premières naissances ont eu lieu cette année.
Le bébé tortue âgé de quelques jours s’agite dans la main de Charlotte Ducotterd. Le minuscule reptile espère sans doute retourner vite dans le petit aquarium qui lui sert de nurserie. Cette scène, qui se déroule dans les locaux du centre Emys à Chavornay (VD), porte en elle un petit miracle : c’est la première fois qu’une reproduction de tortue cistude fonctionne dans ce lieu géré par l’association Protection et Récupération des Tortues, très active dans le programme de réintroduction de la seule tortue indigène de Suisse.
A lire aussi : notre dossier spécial sur la cistude !
Considérée comme disparue de nos contrées au début du 21e siècle, la cistude ne doit son salut qu’à quelques populations relictuelles qui ont été trouvées dans les années 2000, d’abord dans la réserve du Moulin-de-vert dans la campagne genevoise. “Les tortues qui ont été trouvées en Suisse ont toutes été relâchées par des naturalistes au cours du 20e siècle” juge Charlotte Ducotterd, qui connaît ces petits animaux depuis son enfance. Ce sont ses parents qui ont fondé le centre Emys en 1994. Puis elle est devenue elle-même biologiste et spécialiste de la cistude au sein d’Info fauna, la fondation qui cartographique la faune en Suisse.


Une reproduction à rythme de… tortue
Sans les réintroductions “sauvages” de la cistude, le reptile aurait sûrement disparu à jamais. La découverte de sa présence a permis de la protéger au niveau fédéral. Mais avant son inscription sur la liste rouge des espèces en danger, un débat a eu lieu pour savoir si cette petite tortue à la peau sombre tachetée de points jaunes était réellement indigène. La réponse fut “oui”, car il a été prouvé que les habitants consommaient sa chair au Moyen-âge en Suisse.
Classée “en Danger critique d’extinction” suite à sa redécouverte, la cistude a alors bénéficié à partir de 2010 d’un programme de réintroduction - ou plutôt de “renforcement” _ qui doit permettre à cette espèce d’être à nouveau viable naturellement. Emys orbicularis se reproduit en effet lentement - 1 à 2 jeunes survivent en moyenne parmi les œufs pondus annuellement par une tortue génitrice - et colonisent encore plus lentement de nouveaux territoires. Rappelons-nous qu’elle se déplace en effet à la vitesse d’une… tortue. Il lui faut donc un coup de pouce des humains, qui ont détruit 90% de son habitat en asséchant les marais qu’elle affectionne.
Au centre Emys, plusieurs plans d’eau creusés en extérieur abritent une dizaine de mâles et de femelles adultes qui ont été importés du marais de la Brenne en France et d’Argovie. Les accouplements ont lieu au printemps. Mais les années précédentes, les œufs pondus sur le rivage étaient systématiquement mangés par des renards. Pendant l’hiver 2024-2025, un solide grillage a été construit tout autour et au-dessus des enclos. Résultat : les œufs ont cette fois éclos.
De 500 à 1000 tortues
Les jeunes nés en avril-mai ont été relâchés le 13 juin dans la réserve de la Grande Cariçaie sur les rives du lac de Neuchâtel. L’objectif est de constituer une nouvelle population de tortues dans cette zone. D’autres lâchés interviendront jusqu’en 2028 au même endroit. “Pour chaque projet de réintroduction, on relâche en quelques années une cinquantaine de tortues de plusieurs provenances pour limiter la consanguinité. Des tests sont ensuite menés pour voir s’il y a des reproductions à l’état sauvage”, note Charlotte Ducotterd.
Aux étangs de Prés Bordon (GE) où a eu lieu la première réintroduction en 2010, il a fallu attendre six ans pour observer des naissances naturelles. Mais un vent d’optimisme souffle dans le dos des êtres à carapace. Il y a 15 ans, seules 500 tortues subsistaient à l’état sauvage. Elles sont aujourd’hui autour de 1000. “Le but de ma vie, c’est que la cistude change de statut de mon vivant. J’aimerais qu’elle passe de “En danger critique” à “vulnérable””, souffle la chercheuse Charlotte Ducotterd. Elle peut y croire. Dans la fable, la tortue avance doucement… mais sûrement.
3 questions à… Gaël Pétremand, responsable du suivi de la faune à l’association de la Grande Cariçaie
Un lâcher de cistudes a eu lieu le 13 juin dernier dans la réserve naturelle de la Grande Cariçaie à Cheyres (FR) sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Comment s’est déroulée cette opération ?
C’est un projet porté par le canton de Fribourg et nous avons le rôle d’accompagnant. Il y a 15 ans, une étude avait été menée pour identifier les endroits les plus favorables à des lâchers de tortues cistudes. Le parc sauvage de la Vieille Thielle (NE), les étangs de Prés Bordon (GE) et donc la Grande Cariçaie avaient été identifiés comme les meilleurs sites. Depuis, il y avait eu des lâchers dans les deux premiers, mais pas encore sur les rives du lac de Neuchâtel. C’est désormais chose faite !
Combien de tortues ont été relâchées à cette occasion ?
Une vingtaine de subadultes, dont certains spécimens équipés d’émetteurs GPS, et une quarantaine de juvéniles ont été lâchés sur les bords du lac. L’an prochain, il y aura de nouveaux lâchés. Ces tortues viennent d'élevages, du centre Emys par exemple, ou de prélèvements parmi des populations sauvages conséquentes du canton de Genève.
Quel est le plus gros défi dans ces opérations ?
Il est difficile d’obtenir des individus de la part des centres d’élevages, car la reproduction des cistudes est lente. Il y a aussi la difficulté de faire un suivi. Dans l’immense zone humide de la Grande Cariçaie, il est presque impossible de retrouver un individu sans émetteur et les juvéniles n’en sont pas équipés car trop petits. Cela complique la tâche de savoir comment se porte une population réintroduite. Mais pour préserver la sous-espèce originaire du Plateau suisse, Emys orbicularis orbicularis, qui diffère d’une autre sous-espèce présente au Tessin, les scientifiques ont besoin de géniteurs et génitrices de la même souche, alors que les individus relâchés dans des étangs il y a quelques décennies étaient des hybrides.
Catégorie
Ces produits pourraient vous intéresser
Poursuivez votre découverte
La Salamandre, c’est des revues pour toute la famille
Plongez au coeur d'une nature insolite près de chez vous
Donnez envie aux enfants d'explorer et de protéger la nature
Faites découvrir aux petits la nature de manière ludique
merci de ne pas les utiliser sans l'accord de l'auteur